XXe-XXIe siècles
-

Arrivé à Paris en octobre 1910, Pierre Reverdy s’installe sur la Butte Montmartre où, grâce à Max Jacob, il rencontre Juan Gris, puis Pablo Picasso dont l’amitié se double d’une profonde admiration. Au nombre de ceux qui élargissent ensuite ce cercle d’amis, il faut compter Georges Braque, Fernand Léger, Henri Laurens, Pablo Gargallo, Guillaume Apollinaire ou Maurice Raynal. Donnant toute leur valeur aux échanges féconds qui s’y nouent, Pierre Reverdy conçoit ses premiers recueils poétiques comme autant de livres de dialogue. Et cela, au sens où le geste d’écrire se met ostensiblement à l’affût des échos que lui offre le tracé du dessin. Car plus encore que d’une simple conjonction du texte et de l’image plastique, les recueils témoignent d’un art combinatoire dont l’invention est constante, de telle sorte que le poème se donne autant à lire qu’à voir dans sa disposition propre sur la page, en même temps que sa configuration plastique oriente une lecture multiple et ouverte. Attentive aux modalités de ces échanges subtils (la plasticité des mots, ou celle des lignes dessinées par l’agencement des vers y étant aussi de l’ordre du mouvement), Isabelle Chol interroge l’ensemble de l’œuvre, pour montrer comment les formes visibles des textes en constituent l’horizon sensible, faisant de la page un espace qu’il incombe au poète et au lecteur d’investir tour à tour. Pierre Reverdy : poésie plastique décrit la corrélation des poèmes à l’acte de leur composition, voire au processus dynamique de figurabilité qui en résulte.
-

C’est à la respécification de l’objet juridique, dans la dimension morale de son déploiement, que cet ouvrage s’attache. Son but est d’observer, en contexte, les pratiques d’une grande variété de gens impliqués dans ou confrontés à l’institution de la justice. Plus particulièrement, son objectif est d’étudier et de décrire, de manière empiriquement documentée et détaillée, comment se produit et se manifeste la dimension nécessairement morale de l’activité judiciaire et comment cette dernière modalise le traitement d’affaires touchant à la morale.
Le contexte de cette étude est spécifique : il s’agit de l’enceinte de parquets et tribunaux égyptiens et d’affaires qui y ont été traitées au tournant du xxie siècle. Mais son ambition va bien au-delà de la présentation d’un système juridique particulier, il ouvre à une sociologie du droit en contexte et en action – ce qu’on pourrait appeler la praxéologie du droit.
Après avoir posé le cadre analytique de sa démarche, l’ouvrage – nourri de très nombreux extraits d’affaires – procède en quatre temps. Il s’agit d’abord de fonder l’approche praxéologique des relations qu’entretiennent droit et morale, en partant du traitement classique de cette question, en introduisant l’idée d’une structuration morale de la cognition ordinaire et judiciaire et en s’arrêtant aux apports de la démarche ethnométhodologique. C’est ensuite à l’activité judiciaire et à l’organisation morale de son exercice que le livre s’intéresse. À cette fin, la question du contexte de l’activité judiciaire et les notions de contrainte procédurale et de pertinence juridique sont développées. Puis il déroule une grammaire pratique de quelques grands concepts du droit, tels la personne, la cause ou l’intention. Enfin, il analyse de manière détaillée une affaire qui mit en cause une cinquantaine d’hommes pour leur homosexualité présumée. Sont ici décortiqués les langages de la décision de justice et de l’interrogatoire du Parquet, ainsi que les différents jeux de catégorisation qui traversent ces activités. En conclusion, l’ouvrage revient sur les relations entre droit et morale à la lumière de la démarche praxéologique qu’il a déployée.
-
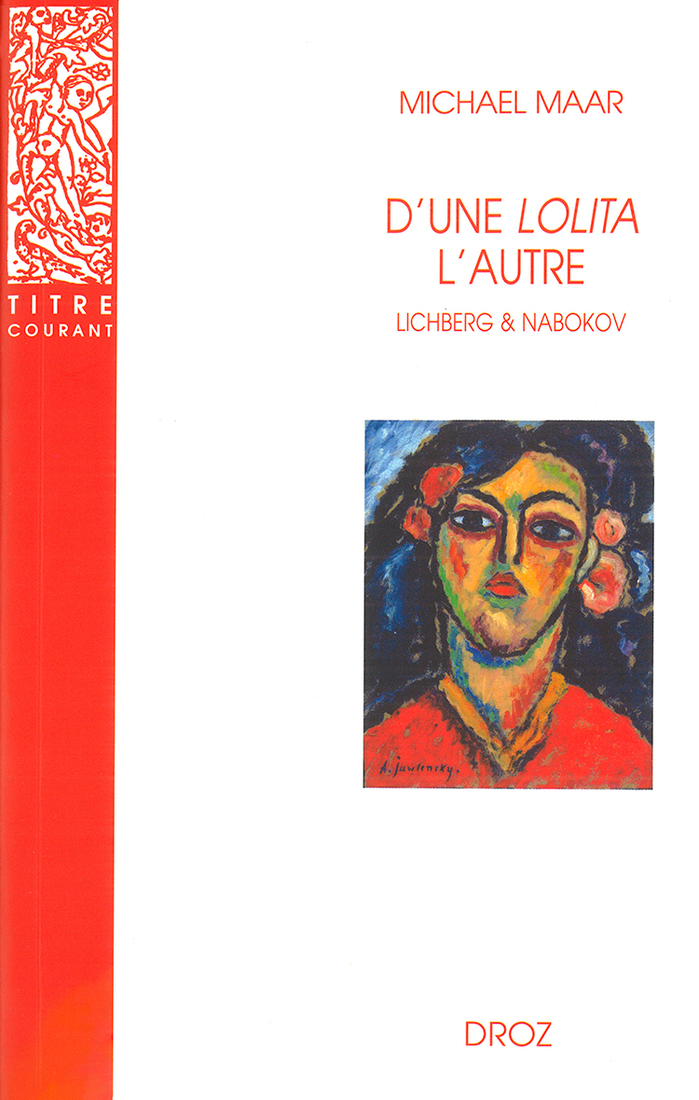
Quand Michael Maar publia en mars 2004 dans la Frankfurter Allgemeine Zeitung, aussitôt relayée par le Times Literary Supplement, qu'une nouvelle intitulée Lolita avait paru près de quarante ans avant le célèbre roman de Vladimir Nabokov, il déclenchait un débat de portée internationale et provoquait un vif émoi parmi les Nabokoviens. Son propos est né de la découverte, extraordinaire, de la Lolita publiée par Heinz von Lichberg, nom de plume d'Heinz von Eschwege, à Darmstadt en 1916. Or, le motif littéraire développé par Lichberg est déjà celui qui, en 1955, animera l'inoubliable nymphette. Pour faire bref, on peut dire qu'entre 1916 et 1955, de Lichberg à Nabokov, de la pâleur d'une Lolita, Darmstadt au scandale qui agita Lolita, Texas, on passe d'une ébauche façonnée par un journaliste plumitif, désormais tombé dans l'oubli, à un chef-d'œuvre de la littérature mondiale. Il n'en demeure pas moins que de singuliers liens surgissent, qu'il suffise de citer les sources hoffmanniennes de Lichberg et l'attraction d'E.T.A. Hoffmann sur Nabokov ; la vie d'exilé menée par ce dernier à Berlin de 1922 à 1937, et sa fréquentation du milieu littéraire ; l'enchâssement de citations et d'allusions auquel a excellé Vladimir Nabokov et dont il a émaillé son œuvre tout aussi bien que l'exégèse ironique qu'il en a donnée ; enfin, et surtout, la question irrésolue de la source et du chef-d'œuvre que l'on aimerait croire produit ex nihilo. Autant de sujets qu'examine Michael Maar en convoquant tour à tour les arguments historiques et la critique littéraire pour ébranler l'édifice hasardeux de la coïncidence.
-
-
L’auteur de cet ouvrage, sans négliger totalement les rapports bilatéraux, étudie surtout, en utilisant la presse, les documents diplomatiques et les récits de voyages, les regards réciproques que les deux pays portent l’un sur l’autre.
La Suisse ne s’intéresse au Portugal que lorsque s’y produisent des événements majeurs: l’Ultimatum anglais de 1890, l’assassinat du roi Carlos en 1908, la révolution républicaine de 1910, l’entrée du Portugal dans la Grande Guerre en 1916, le coup d’État militaire de 1926 et la révolte de février 1927.
Les Portugais admirent la Suisse pour son organisation politique, l’efficacité de son système scolaire et le civisme de ses habitants.
Ce «modèle» suisse ne peut pas être exporté vers le Portugal, car il y a trop d’écart entre le deux pays. L’élite portugaise subit cependant l’influence des pédagogues suisses notamment celle d’Édouard Claparède et d’Adolphe Ferrière.
-
-

L’organisation des chemins de fer en France sous la IIIe République constitue une expérience originale d’économie mixte qu’illustrent les relations entre l’Etat et les grandes compagnies de chemins de fer créées au milieu du XIXe siècle. Les études financières anciennes du Crédit lyonnais, que présente François Caron, retracent l’histoire contrastée de chacune de ces compagnies et l’évolution complexe du régime des chemins de fer jusqu’à la création de la SNCF en 1937.
Y est mis en évidence le rôle majeur, mais très particulier dans l’histoire de l’épargne française, des obligations de chemin de fer, qui ont dominé les émissions de valeurs à revenu fixe jusqu’en 1900. Une réflexion originale est proposée, qui traite des aspects économiques de la grande dépression et de l’influence des stratégies commerciales des compagnies sur l’évolution de l’économie française dans les années 1870-1900. Des explications sont fournies sur la crise financière subie par les compagnies à partir de 1900, qui se traduit, dans un contexte de hausse de la Bourse, par la chute de leurs cours ; dans les années 1920 et 1930, un examen lucide et critique est posé sur la tentative de sauvetage du système à travers la convention de 1921 et sur les incohérences de son application. Ces études ainsi mises en perspective constituent autant d’illustrations du débat toujours actuel sur le rôle de l’Etat et du Marché.
-
-

Le journal d’écrivain parle du monde, et c’est bien souvent avec les mots des autres qu’il le fait, signalant en lui la présence explicite d’un déjà dit qu’il circonscrit. Situation paradoxale que celle d’une énonciation qui souligne l’altérité à l’intérieur de sa progression, mais la repousse fictivement hors d’elle par un geste de délimitation, dans le déni du dialogisme constitutif de toute parole. Reconnaissant en lui la présence ponctuelle d’autres discours, le journal offre un tracé de frontières mouvantes et complexes, cartographies imaginaires où s’esquisse l’illusion d’un territoire à soi, propice au déploiement de la fiction de soi. C’est à l’étude des autoportraits proposés par trois journaux du XXe siècle, ceux de Paul Léautaud, de Jean Malaquais et de Renaud Camus, que s’attache cet essai, dans l’observation du jeu singulier de formes langagières qui suggèrent la présence localisée et circonscrite de l’autre, et s’avèrent dès lors masque et indice d’une présence dialogique dynamique souterraine.
-

La Crise du français consigne les cinq conférences que Charles Bally, professeur de linguistique à l’Université de Genève, a données en 1930. L’ouvrage qui en ressort, court et incisif, encourage le débat sur la langue française et son enseignement. Il explore un des thèmes fondamentaux de la pensée du langage, celui de la " crise " d’une langue telle qu’elle est expérimentée ou imaginée dans la société, à travers la presse, chez les intellectuels et dans les représentations de l’homme ordinaire. Le grand linguiste saisit ce débat pour exposer sa conception de la langue maternelle et des mécanismes de son acquisition par l’enfant ; il développe une critique des opinions dominantes relatives à l’apprentissage et à l’enseignement du français, en particulier de la grammaire. Les solutions novatrices qu’il a avancées en 1930 restent intéressantes à discuter et demeurent d’actualité pour la didactique des langues.
L’avant-propos et la postface, par Jean-Louis Chiss et Christian Puech, rétablissent La Crise du français dans le cours de la réflexion linguistique, pédagogique et culturelle depuis la seconde moitié du XIXe siècle.